Colloque international organisé sous le haut patronage de l’Académie française à l’occasion du quatrième centenaire de la naissance de Blaise Pascal par la Fondation Singer-Polignac, le Centre d’études cartésiennes et le Centro di Studi su Descartes e il Seicento – Ettore Lojacono
Comité d’honneur
- Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française
- Xavier Darcos, de l’Académie française, Chancelier de l’Institut
- Michel Zink, de l’Académie française, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
- Michael Edwards, de l’Académie française
- Jean-Luc Marion, de l’Académie française
- François Sureau, de l’Académie française
- Jean-Robert Armogathe, de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
- Nathalie Drach-Temam, Présidente de Sorbonne Université
- Fabio Pollice, Président de l’Università del Salento
- Giulia Belgioioso, Directrice émérite du Centro di Studi su Descartes et il Seicento — Ettore Lojacono
Programme
Lundi 19 juin 2023
13h30 Accueil et inscription des participants
14h Accueil par Michel Zink, de l’Académie française, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
14h15 Introduction du colloque par Vincent Carraud
14h30 “Leur cuisine était en désordre et leur marmite renversée” : la difficile sortie de la France de la guerre espagnole (1653-1662) par Olivier Chaline
SESSION 1 : 1647-1656
Président de séance : Michel Zink
15h10 Le contexte exégétique de la querelle sur le vide : Mersenne par Claudio Buccolini
15h50 De l’esprit géométrique : échec et relance d’un art de persuader par Gilles Olivo
16h30 Saint Prosper selon les Écrits sur la grâce par Pierre Lyraud
17h10 Pause café
17h30 Approches de l’Écrit sur la conversion du pécheur par Gérard Ferreyrolles
18h10 “Le cœur sent que les nombres sont infinis”. Le cœur et l’infini selon Pascal par Tamás Pavlovits
18h50 Fin de la première journée
Mardi 20 juin 2023
9h30 Accueil et inscription des participants
SESSION 2 : 1656-1662 et après
Président de séance : Emmanuel Cattin
9h45 Pascal et le Pugio fidei par Dan Arbib
10h25 “Je suppose qu’on croit les miracles”. La fin des Provinciales par Alberto Frigo
11h05 Pause café
11h25 Antoine Arnauld et la signature du Formulaire par Jean-Robert Armogathe
12h05 Ressource apologétique ou venin janséniste ? Une édition des Pensées devant l’Index en 1896 par Jean-Louis Quantin
12h45-13h Annonce de l’invention du plus vieil imprimé des Pensées par Thibaut Bagory
13h-14h Pause déjeuner
SESSION 3 : Les Pensées, de Platon à Heidegger
Président de séance : Walter Schweidler
14h Correspondances. Platon pour disposer à Pascal par Rosaria Caldarone
14h40 Réalité, vérité, persuasion. Ontoéthique pascalienne du dépassement d’une dissociation moderne par Alberto Peratoner
15h20 “Quand tout se remue, rien ne se remue”. Pascal, Heidegger et la vie facticielle par Sylvain Josset
16h Pause café
16h30 Logos, ordre du cœur, Befindlichkeit. Phänomenologische Annäherungen an Pascal par Paola-Ludovika Coriando
17h15 Table ronde : Traduire les Pensées
Présidente de séance : Giulia Belgioioso
Avec la participation de Vlad Alexandrescu (roumain), Roger Ariew (anglais), Dongxing Chen (chinois), Tamás Pavlovits (hongrois), Tetsuya Shiokawa (japonais), Irène Thirouin (coréen).
18h30 Fin de la deuxième journée
Mercredi 21 juin 2023
9h30 Accueil et inscription des participants
SESSION 4 : Vers une nouvelle apologétique
Président de séance : Igor Agostini
9h45 La Comparaison des chrétiens des premiers temps avec ceux d’aujourd’hui : perspectives intertextuelles par Michael Moriarty
10h25 “Ceux qui ont traité de la connaissance de soi-même”. Pascal et les lecteurs de Charron par Édouard Mehl
11h05 Pause café
11h25 Le pari de Pascal à la lumière des apologétiques de son temps par Roger Ariew
12h05 Travailler pour l’incertain par Laurent Thirouin
13h-14h Pause déjeuner
SESSION 5 : Figure et présence
Président de séance : Jean-Luc Marion
14h “Les figures étaient de joie”. Paul Beauchamp lecteur de Blaise Pascal par David Rabourdin
14h40 Voir après Balthasar par Yoen Qian-Laurent
15h20 Une « christologie » de Pascal ? Le palimpseste pascalien par Vincent Holzer
16h Pause café
16h30 La question de l’être par Vincent Carraud
17h10 Conclusion générale du colloque par Jean-Luc Marion
17h30 Clôture du colloque
Biographies
Igor Agostini

Igor Agostini est professeur à l’université du Salento. Il dirige le Centro Dipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento – Ettore Lojacono. Coordinateur du Doctorat international en philosophie « Formes et histoire de la connaissance philosophique (Université du Salento/Sorbonne Université/Universität zu Köln) », il est aussi membre statutaire du Centre d’études cartésiennes, Sorbonne Université et membre permanent de l’École des enseignants de l’ED 433 « Concepts et langages », Sorbonne Université. Il a été Visiting Fellow en 2013 et 2014 au département de philosophie de l’université de Princeton, professeur invité à l’École normale supérieure de Paris en 2015, à l’université d’Uberlandia (Brésil) en 2014, 2018 et 2022, à l’université de Caen Basse-Normandie en 2019 et à Sorbonne Université en 2021-2022. Il est l’auteur de cinq livres et de plus de soixante-dix articles et essais, ainsi que de nombreuses éditions et traductions de textes philosophiques, dans le domaine de la pensée moderne de Descartes à Kant, notamment dans ses rapports avec la seconde scolastique.
Il a collaboré à la publication en trois volumes, sous la direction de Giulia Belgioioso, de l’ensemble des œuvres de Descartes chez Bompiani, Milan (2005-2009). Il a aussi participé à l’édition française des œuvres de Descartes par J.-M. Beyssade et D. Kambouchner, chez Gallimard.
Vlad Alexandrescu

Vlad Alexandrescu est docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, professeur à l’Université de Bucarest, et directeur du Centre de recherches « Fondements de la Modernité Européenne ». Il est aussi co-directeur de la revue Journal of Early Modern Studies. Il est auteur des livres suivants : Le paradoxe chez Blaise Pascal, Peter Lang, Berne, 1996 ; Croisées de la modernité. Hypostases de l’esprit et de l’individu au XVIIe siècle, Zeta Books, Bucarest, 2012 (prix « P. G. Castex » de l’Académie des Sciences Morales et Politiques).
Dan Arbib

Dan Arbib, ancien élève de l’Ecole normale supérieure, agrégé et docteur en philosophie, est professeur agrégé à l’Ecole normale supérieure. Secrétaire scientifique du Bulletin cartésien depuis 2010, il a publié La lucidité de l’éthique. Etudes sur Levinas (Hermann, 2014), Descartes, la métaphysique et l’infini (PUF, 2017, 2e éd. 2021) et dirigé le collectif consacré aux Méditations métaphysiques de Descartes, Objections et Réponses (Vrin, 2019).
Roger Ariew
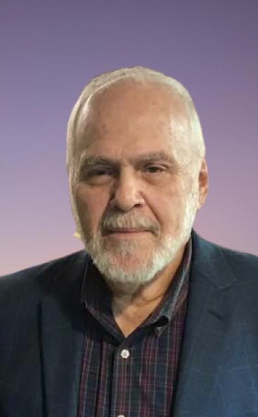
Roger Ariew est Professeur émérite à l’Université de Floride du Sud. Il est l’auteur de Descartes among the Scholastics (Brill, 2011) et Descartes and the First Cartesians (Oxford, 2014), et travaille actuellement sur The Correspondence of René Descartes : New Critical Edition and Complete English Translation, avec Erik-Jan Bos et Theo Verbeek (Oxford, en cours).
Jean-Robert Armogathe
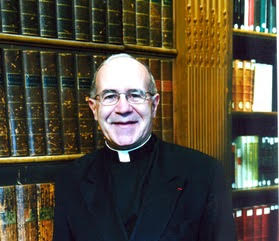
Jean-Robert Armogathe, membre de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), directeur d’études honoraire à l’EPHE/PSL, président de la Société d’étude du XVIIe siècle.
Directeur de l’Histoire générale du christianisme (2 vol. PUF, 2009), il a publié (avec Daniel Blot) une édition comparative de l’édition de Port-Royal avec les copies et les versions modernes (Champion, 2011). Parmi de nombreux travaux sur le XVIIe siècle : Descartes, Correspondance (2 vol., Gallimard, TEL, 2013) et Descartes, Correspondance avec Élisabeth de Bohême et Christine de Suède (Gallimard, Folio Classique, 2018), Études sur Antoine Arnauld (Classiques Garnier, 2018).
Thibaut Bagory

Ancien élève de l’ENS Paris-Saclay, agrégé de Mathématiques, diplômé d’un master 2 recherche en Algèbre appliquée, ainsi que d’un master 2 recherche en Histoire des sciences et Philosophie des sciences, M. Thibaut Bagory est doctorant sur « L’être géomètre chez Pascal » sous la direction de M. Laurent Thirouin, professeur des universités en Littérature française.
Giulia Belgioioso

Giulia Belgioioso a enseigné l’histoire de la philosophie à l’Université du Salento à Lecce. Professeur invitée à l’Ecole pratique des hautes études, à Sorbonne Université et dans plusieurs Universités aux Etats Unis, au Japon et au Brésil, elle a fondé en 1998 le Centre d’études sur Descartes et le XVIIe siècle (Centro dipartimentale di Studi su Descartes « Ettore Lojacono »), dont elle est directrice honoraire. Parmi ses nombreuses publications, il convient de retenir, outre ses ouvrages personnels, la première traduction complète des Œuvres et des lettres de Descartes en italien, 3 volumes bilingues chez Bompiani à Milan ainsi que la correspondance croisée Descartes-Beeckman-Mersenne. Elle a organisé et publié plusieurs grands colloques internationaux (sur le Discours et les Essais, sur les Principia, sur les Passions de l’âme et sur la Correspondance) et dirigé plusieurs collections, dont actuellement The Age of Descartes chez Brepols. Un volume d’hommages Cartesius edoctus lui a été offert en 2022.
Claudio Buccolini

Claudio Buccolini, Docteur en philosophie (EPHE), chercheur au CNR (ILIESI) enseigne Histoire de la Philosophie Moderne à l’Université de Rome. Il a travaillé sur la pensée de Marin Mersenne et son rôle dans la diffusion et la réception du cartésianisme, sur le scepticisme des débuts de l’âge classique, sur l’histoire philosophique du rêve en relation avec les théories de la conscience.
Parmi ses publications récentes: Les songes de 1619: contexte et réception (Mirabilis scientiae fundamenta. Neuburg 1619 :Der Anfang Der Kartesischen Philosophie, Karl Alber, 2023); L’exégèse du dernier Mersenne et le cartésianisme (The Philosophers and the Bible, Brill, 2022); Superstitio, special section ed. by C. Buccolini and E. Pasini (Lexicon Philosophicum International Journal for the History of Texts and Ideas, 9 , 2021); Scepticisme et Dieu trompeur : les contextes mersenniens («Les Etudes Philosophiques», 2021); Somnia. Il sogno dall’antichità all’età moderna, éd. par C. Buccolini et P. Totaro, ILIESI, 2020.
Rosaria Caldarone
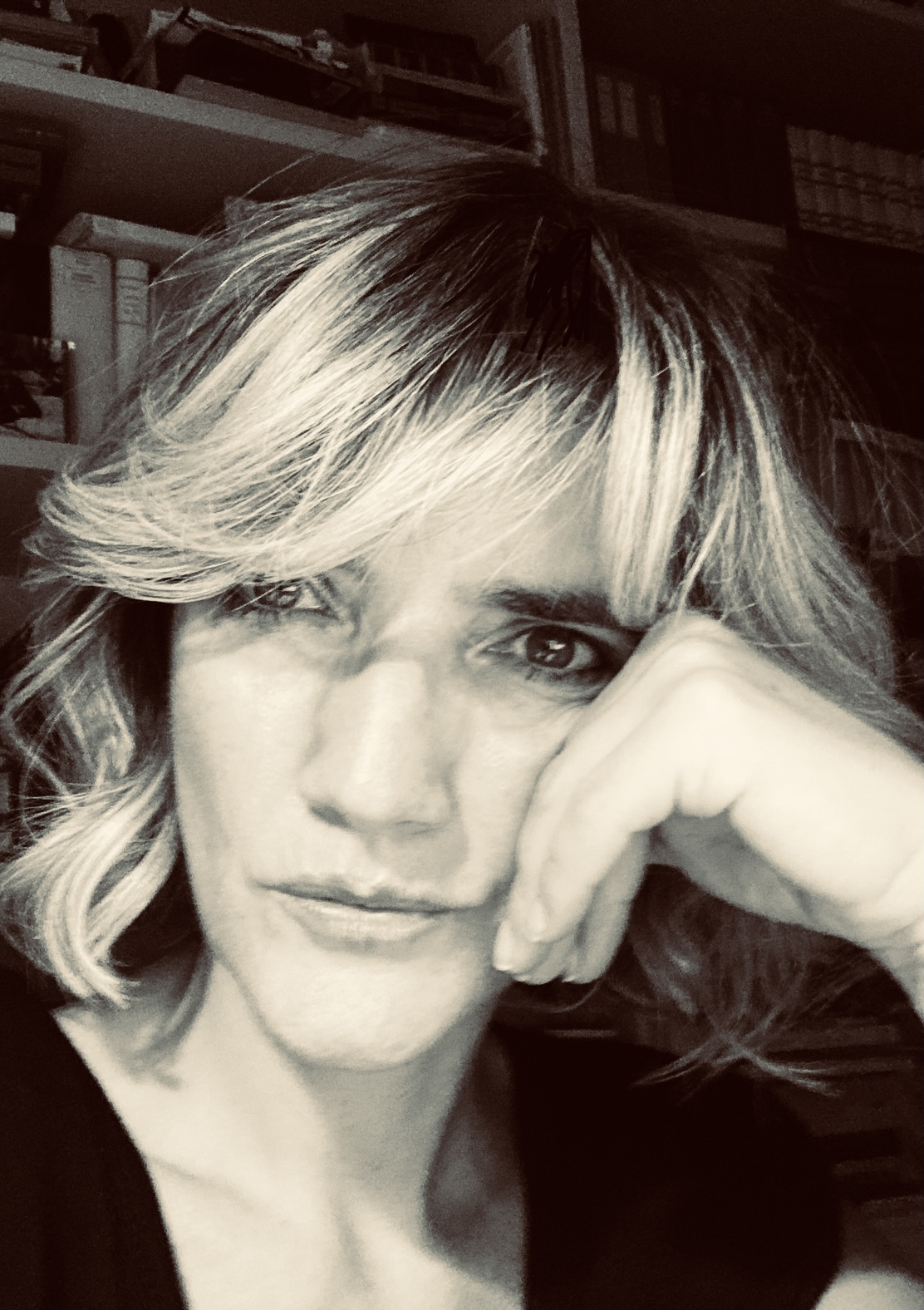
Rosaria Caldarone est professeur de Filosofia Teoretica au Département de Sciences humaines de l’Université de Palerme et Directrice de programme au Collège Internationale de Philosophie de Paris. Dans ses travaux, la question de l’éros s’impose comme le facteur décisif pour comprendre le statut de la philosophie et pour l’approche de la question du sujet.
Parmi ces études figurent: Eros decostruttore. Metafisica e desiderio in Aristotele (il melangolo, 2001); Caecus amor. Jean-Luc Marion e la dismisura del fenomeno (ETS, 227); Impianti. Tecnica e scelta di vita (Mimesis, 2011) ; Lo scambio di figura. Tre saggi sulla somiglianza e sulla differenza (Inschibboleth, 2015); La filosofia in fiamme. Saggio su Pascal (Morcelliana, 2020).
Vincent Carraud
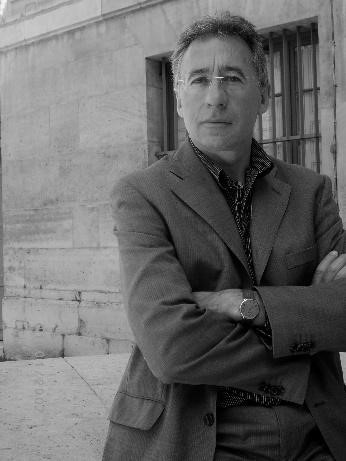
Vincent Carraud est professeur d’histoire de la philosophie moderne en Sorbonne et directeur du Centre d’études cartésiennes. Il a reçu en 2010 le grand prix de philosophie de l’Académie française. Il est l’auteur de nombreux travaux sur Pascal, notamment Pascal et la philosophie (Puf, Épimethée, 2007 [1992], Quadrige, 2023), Pascal. Des connaissances naturelles à l’étude de l’homme (Vrin, 2007) et Pascal : de la certitude (Puf, 2023).
Olivier Chaline

Olivier CHALINE, ancien élève de l’ENS, professeur d’histoire moderne à Sorbonne Université. Thèmes de recherches : France XVIIe-XVIIIe siècles ; histoire de l’Europe centrale ; histoire de la guerre (terre et mer) ; histoire maritime. Directeur de la FED 4124 « Histoire et archéologie maritimes », directeur-adjoint de l’Institut de l’océan de l’Alliance Sorbonne Université.
Le Règne de Louis XIV, Paris, Flammarion, 3e éd., 2015 ; L’année des quatre Dauphins, Paris, Flammarion, 2e éd., 2015 ; « La vie militaire du jeune Descartes au début de la guerre de Trente Ans », dans Dan Arbib, Vincent Carraud, Edouard Mehl, Walter Schweidler Mirabilis scientiae fundamenta. Neuburg 1619 : les commencements de la philosophie cartésienne, Eichstätter Philosophische Beiträge, Karl Alber Verlag, 2023, p. 39-59.
Dongxing Chen

Dongxing Chen est diplômé de l’université du Shandong et de Pékin. Ses recherches doctorales à Sorbonne Université sous la direction de Vincent Carraud portent sur le rôle de la sensation dans la recherche de la vérité selon Descartes. Il a également publié plusieurs articles en études cartésiennes en chinois et en français, et s’intéresse de près aux problèmes liés à la traduction de la pensée cartésienne, et plus généralement de la métaphysique occidentale, en langue chinoise.
Paola-Ludovika Coriando

Paola-Ludovika Coriando est née à Gênes en 1969. Elle est Professeure de philosophie à l’Université d’Innsbruck depuis 2009. Les thèmes principaux de sa recherche sont l’ontologie, la métaphysique et sa critique, la phénoménologie et l’herméneutique Elle a écrit plusieurs livres, parmi lesquels Der letzte Gott als Anfang. Zur ab-gründigen Zeit-Räumlichkeit des Übergangs in Heideggers „Beiträgen zur Philosophie (Vom Ereignis)“ (München, Fink, 1998) et Affektenlehre und Phänomenologie der Stimmungen. Wege einer Ontologie und Ethik des Emotionalen (Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2002).
Xavier Darcos

DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
CHANCELIER DE L’INSTITUT DE FRANCE
Xavier Darcos est un latiniste, haut fonctionnaire, homme de lettres, diplomate, homme politique et académicien français.
Gérard Ferreyrolles

Gérard Ferreyrolles est Professeur émérite de littérature française à Sorbonne Université. Il a notamment publié Pascal et la raison du politique (PUF, 1984), Les Reines du monde. L’imagination et la coutume chez Pascal (Champion, 1995) et, en collaboration, Bossuet (PUPS, 2008). Il a ensuite dirigé chez Champion l’édition des principaux Traités sur l’histoire (1638-1677) du XVIIe siècle. Lauréat du Prix Pierre-Georges Castex (Académie des Sciences morales et politique) en 2012 et, pour De Pascal à Bossuet. La littérature entre théologie et anthropologie (Champion, 2020), du prix Émile Faguet 2021 (Académie française).
Alberto Frigo

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Pise, agrégé et docteur en philosophie, Alberto Frigo est professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’Université des études de Milan. Il est l’auteur de deux monographies consacrées à Pascal, L’évidence du Dieu caché. Introduction à lecture des Pensées de Pascal (PURH, 2015) et L’esprit du corps. La doctrine pascalienne de l’amour (Vrin, 2016). Il a également édité la correspondance de Montaigne (Le Monnier, 2010) et il vient d’achever l’édition de la Théologie naturelle de Raymond Sebond (original latin et traduction française de Montaigne, 2 vol., Garnier, 2022). Ses derniers essais sont consacrés à la philosophie de la peinture (L’expérience peinture. Le temps, l’intérêt et le plaisir, Fage, 2020) et à l’histoire des idées (Charité bien ordonnée, de saint Augustin à Goethe. Six études, Cerf, 2021).
Vincent Holzer

Vincent Holzer est docteur et Professeur en Théologie. Il enseigne la théologie systématique à la faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris, et est titulaire de la Chaire de théologie trinitaire. Il est directeur de l’UR-RCS de l’Institut Catholique de Paris et vice-recteur de l’Institut Catholique de Paris. Il est ancien titulaire de la Chaire de Philosophie et Théologie Dominique Dubarle, membre de l’Académie Pontificale de Théologie, lauréat de l’Académie Française. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : Le Christ devant la raison. La christologie devenue philosophème (Paris, Cerf, 2017), Le Dieu Trinité dans l’histoire. Le différend théologique Balthasar – Rahner, (Paris, Cerf, 1995) et, avec Jérôme de Gramont, La Révélation. Lectures philosophiques & théologiques (Paris, Herrmann, 2020). Il a en outre réalisé une édition et présentation de deux volumes des Œuvres complètes de Karl Rahner : Dogmatique après le Concile. Fondement de la théologie, doctrine de Dieu et christologie (Paris, Cerf, Œuvres 22/1a (2021) et Œuvres 22/1b (2022)).
Sylvain Josset

Sylvain Josset est agrégé de philosophie et ingénieur d’études dans le cadre d’un projet ANR-DFG franco-allemand sur Max Scheler (Sorbonne Université, en partenariat avec l’Université européenne Viadrina de Francfort sur l’Oder). Il achève une thèse de doctorat intitulée La « logique du cœur » selon Pascal. Surmonter le cartésianisme.
Pierre Lyraud

Pierre Lyraud est un ancien élève de l’ENS de la rue d’Ulm (2012), agrégé de lettres classiques (2016), docteur en littérature française (2020), et professeur adjoint en littérature du XVIIe siècle à l’université de Montréal depuis 2022. Il a notamment publié Figures de la finitude chez Pascal, Honoré Champion, 2020 ; une introduction à l’œuvre de Pascal aux éditions du Cerf en 2023 (Pascal, coll. « Qui es tu ? »), ainsi qu’une édition des œuvres pascaliennes (Pascal, L’Œuvre, éd. Robert Laffont/Bouquins, 2023, en collaboration avec Laurence Plazenet). Il a récemment dirigé le volume « Pascal. Corneille. Regards croisés » paru au Courrier Blaise Pascal. Parmi ses derniers articles : « Itinéraire d’un moi gâté : Les Mots de Sartre et les Pensées de Pascal », Études Sartriennes, n° 26, 2022, p. 243-259 ; « Les fantômes de l’honneur. Pascal lecteur du Cid », Courrier Blaise Pascal, n° 44, 2022, p. 35-51 ; « Sous le regard de l’ami : Pascal et l’amitié », dans Delphine Calle et Astrid Van Assche (éd.), L’Amour et l’Amitié au Grand Siècle, Classiques Garnier, 2022, p. 141-147.
Jean-Luc Marion

DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
Professeur émérite à Sorbonne Université et à l’université of Chicago, il est actuellement titulaire de la chaire de philosophie Gadamer au Boston College. Il est membre de l’Académie française et de l’Accademia dei Lincei à Rome.
Les recherches de Jean-Luc Marion portent principalement sur la phénoménologie, la théologie et l’histoire de la philosophie moderne. Parmi ses 38 livres, on peut citer
– en phénoménologie : Réduction et donation, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Reprise du donné (PUF), Le Phénomène érotique (Grasset) ;
– en théologie : L’idole et la distance (Grasset), Dieu sans l’être, Au lieu de soi, l’approche de saint Augustin (PUF) ;
– sur Descartes : Sur l’ontologie grise de Descartes (Vrin), Sur la théologie blanche de Descartes, Sur le prisme métaphysique de Descartes, Sur la pensée passive de Descartes, Questions cartésiennes I, II et III (PUF) ;
Dernière publication : La métaphysique et après (Grasset).
Il a publié en 2020 D’ailleurs, la Révélation (Grasset), qui articule (et récapitule), à partir de la théologie contemporaine et de ses recherches phénoménologiques, une pensée permettant de penser la façon dont Dieu se montre ou se donne aux hommes.
Édouard Mehl

Édouard Mehl est professeur de philosophie moderne à l’université de Strasbourg, et actuellement fellow USIAS (University of Strasbourg Institute for Advanced Studies). Il est également directeur du Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine (CRePhAC, UR2326). Ses travaux portent essentiellement sur l’histoire de la philosophie et des sciences de la période pré-moderne (xv-xvie siècles), sur les querelles cosmologiques de l’âge classique (Descartes, Galilée, Kepler), et sur la première réception française de la phénoménologie husserlienne (Husserl, Jean Héring).
Michael Moriarty

Michael Moriarty est professeur de français à l’université de Cambridge depuis 2011.
Il a été professeur de français à Queen Mary, Université de Londres, entre 1995 et
2011. Il travaille surtout sur la pensée et la littérature françaises du XVIIe siècle (et a également traduit et édité Descartes). Il est Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.
Parmi ses ouvrages, on peut citer :
– Pascal: Reasoning and Belief (Oxford: Oxford University Press, 2020)
– Disguised Vices: Theories of Virtue in Early Modern French Thought (Oxford: Oxford
University Press: 2011
– Fallen Nature, Fallen Selves: Early Modern French Thought II (Oxford: Oxford
University Press, 2006)
– Early Modern French Thought: The Age of Suspicion (Oxford: Oxford University
Press, 2003)
Gilles Olivo

Gilles Olivo est professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’Université de Caen Basse-Normandie.
Principales publications :
- Descartes et l’essence de la vérité, Paris, PUF, 2005
- Descartes, Etude du bons sens, La recherche de la vérité et autres écrits de jeunesse (1616-1631), édition, traduction, présentation et notes, Paris, PUF, 2013 (avec V. Carraud)
Tamás Pavlovits

Tamás Pavlovits est docteur de la Sorbonne. Il a soutenu une thèse de doctorat intitulée « La force de la raison selon Pascal” sous la direction de Pierre Magnard en 2003. Actuellement il est professeur de philosophie à l’Université de Szeged en Hongrie où il dirige le Département de philosophie. Il est également docteur de l’Académie des Sciences en Hongrie. Il est spécialiste de la philosophie de l’âge classique et dirige, avec Dániel Schmal, le Groupe de recherche de l’histoire de la philosophie classique en Hongrie. Il est rédacteur en chef de la revue philosophique Különbség (Différence) et membre de la comité de rédaction de Journal of Early Modern Studies.
Alberto Peratoner

Professeur de métaphysique et théologie philosophique et d’anthropologie philosophique à la Faculté Théologique du Triveneto, au siège de Padoue ; professeur d’ontologie métaphysique et d’épistémologie au Séminaire patriarcal de Venise et de philosophie de la nature et des sciences à l’École de philosophie Benoît XVI de la Fraternité San Carlo (Rome). Depuis 2002, il est également assistant scientifique des activités culturelles de la Congrégation arménienne mekhitariste de Venise, pour laquelle il est chargé en particulier des collections anciennes de la bibliothèque et d’autres projets culturels.
Auteur d’essais dans le domaine philosophique, dont les monographies Blaise Pascal. Ragione, Rivelazione e fondazione dell’etica (Venezia, Cafoscarina, 2002, 2 voll.), Pascal (Rome, Carocci, 2011). Il est également l’auteur de la section « Altre vie della Modernità: Pascal e Vico », de l’ouvrage collectif en 3 vols. Anima, corpo, relazioni. Storia della filosofia da una prospettiva antropologica, Roma, Città Nuova, 2022-2023.
Yoen Qian-Laurent

Yoen Qian-Laurent est agrégé de philosophie et doctorant à Sorbonne Université, sous la direction de V. Carraud. Il est chercheur invité à l’université de Leipzig pour l’année 2022-2023. Sa thèse porte sur le rapport de Pascal à l’idée de vérité.
Jean-Louis Quantin

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (1986). Agrégé d’histoire (1989). Docteur (Université de Paris-Sorbonne 1994), habilité à diriger des recherches en histoire moderne (Université de Paris-Sorbonne 2003).
Depuis le 1er septembre 2002, directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, Section des Sciences historiques et philologiques. Titulaire de la chaire « Érudition historique et philologique, de l’âge classique aux Lumières ».
Frances A. Yates Fellow (The Warburg Institute, 2001). Visiting Fellow, All Souls College, Oxford (2002). Visiting Fellow Commoner, Trinity College, Cambridge (2013).
Membre de l’Accademia Ambrosiana (Biblioteca Ambrosiana, Milan), classe di studi Borromaici, depuis 2001.
David Rabourdin

Docteur en philosophie (Institut Catholique de Paris / Sorbonne Université), licencié en théologie dogmatique, ancien élève de l’ENS-Lyon, David Rabourdin, prêtre du diocèse de Paris, est vicaire à la paroisse de la Trinité (Paris IX). Il enseigne à la Faculté Notre-Dame (Collège des Bernardins) ainsi qu’à l’Institut Catholique de Paris. Il a publié : Pascal, Foi et conversion (PUF, 2013), ainsi que Une puissance d’affirmation, essai sur la philosophie de Claude Bruaire (Hermann, à paraître en 2023).
Walter Schweidler

Le Prof. Dr. Walter Schweidler est titulaire de la chaire de philosophie de l’Université catholique d’Eichstätt-Ingolstadt depuis 2009. De 2000 à 2009 il fut professeur de philosophie pratique à l’Université de Bochum en Rhénanie. Ses centres d’intérêts et de recherches sont les conceptions modernes et contemporaines en éthique et en philosophie politique, la philosophie du droit et la théorie des droits de l’homme, la phénoménologie, la philosophie de Heidegger dans le contexte des courants principaux du XXème siècle, la métaphysique et sa critique, la philosophie interculturelle et la bioéthique. Ses dernières publications sont Wittgenstein, Philosopher of Cultures (éd. W. Carl Humphries, Sankt Augustin, 2017) ; Kleine Einführung in die Angewandte Ethik (Wiesbaden, 2017) ; Wiedergeburt (Freiburg, deux volumes, 2020 et 2022).
Tetsuya Shiokawa

Tetsuya Shiokawa est Professeur émérite à l’Université de Tokyo et membre de l’Académie du Japon. Ses principales publications pascaliennes sont : Pascal et les miracles (A.-G. Nizet, 1975), Entre foi et raison : l’autorité. Études pascaliennes (H. Champion, 2012), Lire les Pensées de Pascal (en japonais) (Tokyo, Éd. Iwanami, 2014), une traduction des Pensées dans la « Bibliothèque Iwanami » en 3 volumes (2015-2016) et une traduction des Opuscules et lettres dans la même bibliothèque (à paraître en août 2023).
Irène Thirouin

Ancienne élève de l’ENS de Paris et du Korean Literature Translation Institute de Séoul, Irène Thirouin-Jung est spécialiste de la traduction littéraire et des transferts culturels entre la France et la Corée.
Laurent Thirouin

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé, docteur HDR, Laurent Thirouin est Professeur émérite de littérature française du XVIIe siècle à l’Université Lumière Lyon 2. Il est l’auteur de divers travaux, qui portent sur l’œuvre de Pascal : Le Hasard et les règles. Le modèle du jeu dans la pensée de Pascal (Vrin, 1991, réédition 2011), Pensées sur la justice (La Découverte, 2011), Le Défaut de la méthode. Lecture des Pensées selon leur ordre (nouvelle édition augmentée, Champion Classiques, 2023), Lectures russes de Pascal (Classiques Garnier, 2020) ; et sur la vie intellectuelle dans le milieu de Port-Royal : l’œuvre morale de Pierre Nicole (Pierre Nicole, Essais de morale, réédition, revue et corrigée, Les Belles Lettres, 2016 ; Traité de la Comédie et autres pièces d’un procès du théâtre, Champion, 1998), la querelle du théâtre (L’Aveuglement salutaire. Le réquisitoire contre le théâtre dans la France classique, Honoré Champion, 1997, rééd. 2007), l’augustinisme au XVIIe siècle (Les Écoles de pensée religieuse à l’époque moderne, textes réunis par Y. Krumenacker et L. Thirouin, Lyon, RESEA, 2006).
Michel Zink

DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
Vice président du conseil d’administration de la fondation Singer-Polignac
Membre de l’American Academy of Arts and Sciences (1997), Vice-président de l’association Sauvegarde des enseignements littéraires, de l’assemblée des professeurs du Collège de France (depuis 2006), Président du conseil d’administration de l’ENS (2004-06), Administrateur de la Société des amis de la Romania, Codirecteur de la Romania, Membre de l’académie de Versailles et de nombreuses sociétés savantes.
Non
Blaise Pascal Lithographie de Gérard Edelinck (1640-1707) et François Quesnel le jeune (1637-699)



