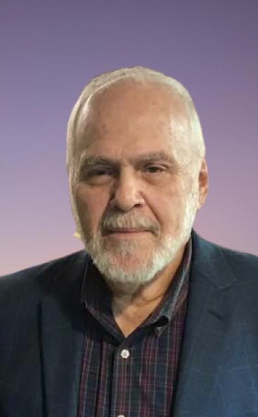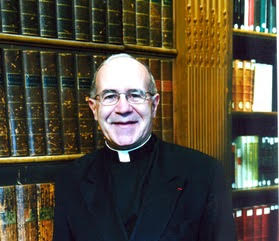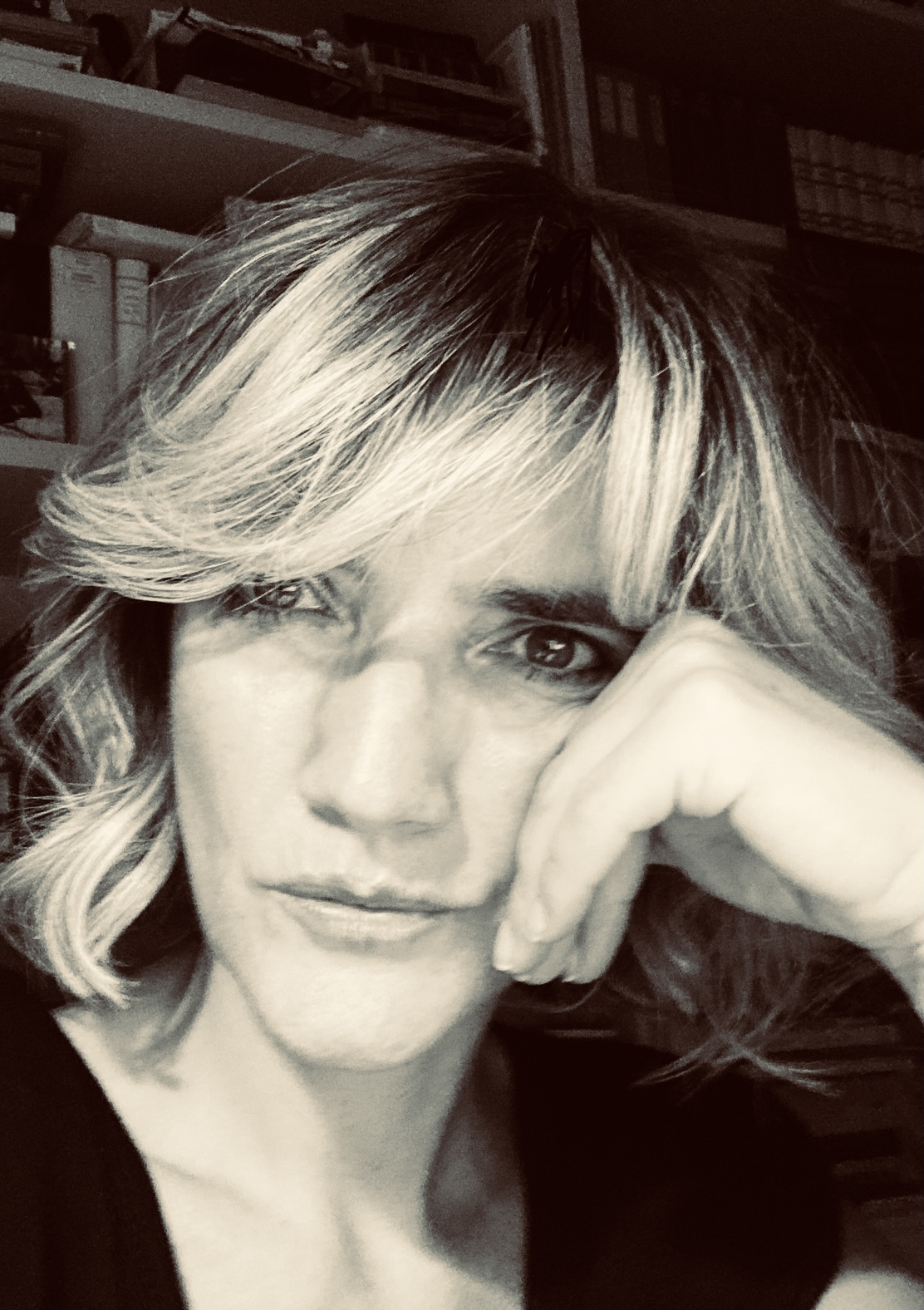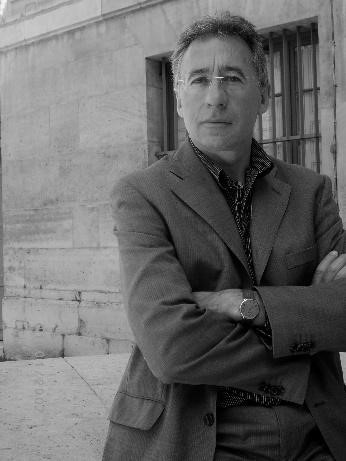en résidence depuis 2023
- Coline Richard flûte
- Moritz Roelcke clarinette
- Gabriel Potier cor
- Jeremy Bager basson
- Yann Thenet hautbois
L’Ensemble Astera est le quintette à vent lauréat du 1er Prix au Concours International de Musique de Chambre Carl Nielsen 2023.
Depuis 2019, soudés par leur amitié et animés d’une passion commune de la musique de chambre, ses musiciens ont à cœur de partager leur vision essentielle en tant que chambristes : le mélange des sons et des timbres de cinq instruments à vent dans un but d’unité et de recherche d’une grande dimension artistique.
Leurs différentes expériences auprès de grands orchestres internationaux enrichissent leur cohésion, leur sonorité unique et leur affinité musicale autour du quintette à vent. Ainsi, l’ensemble franco-suisse représente un véritable vent de fraîcheur dans le paysage classique. Mus par un enthousiasme insatiable, les musiciens mettent leurs énergies au service d’interprétations remarquables, émouvantes, réfléchies et engagées, en utilisant au maximum les possibilités sonores de leur formation.
Comme en témoigne son Prix de la meilleure interprétation de la création au Concours Nielsen, le dynamisme artistique de l’ensemble se caractérise également par son approche du répertoire contemporain et son désir majeur d’amener cette musique innovante dans les salles de concerts.
L’Ensemble Astera se produit dans divers festivals et saisons musicales en Europe, comme par exemple le Lavaux Classic, le festival de Pâques d’Aix-en-Provence, le Davos Festival ou le festival Murten Classics entre autres… L’ensemble est également présent sur les ondes de France Musique, de la Radio Télévision Suisse ou encore de la radio danoise.
Depuis 2023, l’Ensemble Astera est Artiste résident à la Fondation Singer-Polignac à Paris.
Grâce à sa collaboration avec l’ingénieur du son Michael Seberich, et à la résidence offerte par St Columba’s Drimnin Trust en Ecosse, l’Ensemble Astera a enregistré en été 2024 son premier album qui paraîtra prochainement chez le label suisse Claves.
Photo : Ugo Ponte